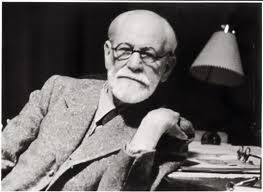Séquence de Travaux Pratiques (TL en demi-groupe) dont l’objectif est double : d’une part, il s’agit d’apprendre à disserter et d’autre part de travailler les notions de Sujet et de Conscience.
La conscience permet-elle au sujet de se connaître lui-même ?
Texte 1
SOCRATE : Comment pourrions-nous maintenant savoir le plus clairement possible ce qu’est « soi-même ». Il semble que lorsque nous le saurons, nous nous connaîtrons aussi nous-mêmes. Mais par les dieux, cette heureuse parole de l’inscription delphique que nous rappelions à l’instant, ne la comprenons-nous pas ?
ALCIBIADE : Qu’as-tu à l’esprit en disant cela Socrate ?
SOCRATE : Je vais t’expliquer ce que je soupçonne que nous dit et nous conseille cette inscription. Il n’y en a peut-être pas beaucoup de paradigmes, si ce n’est la vue.
ALCIBIADE : Que veux-tu dire par là ?
SOCRATE : Examine la chose avec moi. Si c’était à notre regard, comme à un homme que cette inscription s’adressait en lui conseillant : « regarde-toi toi-même », comment comprendrions-nous cette exhortation ? Ne serait-ce pas de regarder un objet dans lequel l’œil se verrait lui-même ?
ALCIBIADE : Evidemment.
SOCRATE : Quel est, parmi les objets, celui vers lequel nous pensons qu’il faut tourner notre regard pour à la fois le voir et nous voir nous-mêmes ?
ALCIBIADE : C’est évidemment un miroir, Socrate, ou quelque chose de semblable.
SOCRATE : Bien dit. Mais, dans l’œil grâce auquel nous voyons, n’y a-t-il pas quelque chose de cette sorte ?
ALCIBIADE : Bien sûr.
SOCRATE : N’as-tu pas remarqué que, lorsque nous regardons l’œil de quelqu’un qui nous fait face, notre visage se réfléchit dans sa pupille comme dans un miroir, ce qu’on appelle aussi la poupée, car elle est une image de celui qui regarde ?
ALCIBIADE : Tu dis vrai.
SOCRATE : Donc, lorsqu’un œil observe un autre œil et qu’il porte son regard sur ce qu’il y a de meilleur en lui, c’est-à-dire ce par quoi il voit, il s’y voit lui-même.
ALCIBIADE : C’est ce qu’il semble.
SOCRATE : Mais si, au lieu de cela, il regarde quelque autre partie de l’homme ou quelque autre objet, à l’exception de celui auquel ce qu’il y a de meilleur en l’œil est semblable, alors il ne se verra pas lui-même.
ALCIBIADE : Tu dis vrai.
SOCRATE : Ainsi, si l’œil veut se voir lui-même, il doit regarder un œil et porter son regard sur cet endroit où se trouve l’excellence de l’œil. Et cet endroit de l’œil, n’est-ce pas la pupille ?
ALCIBIADE : C’est cela.
SOCRATE : Eh bien alors, mon cher Alcibiade, l’âme aussi, si elle veut se connaître elle-même, doit porter son regard sur une âme et avant tout sur cet endroit de l’âme où se trouve l’excellence de l’âme, le savoir, ou sur une autre chose à laquelle cet endroit de l’âme est semblable.
ALCIBIADE : C’est ce qu’il me semble, Socrate.
SOCRATE : Or, peut-on dire qu’il y a en l’âme quelque chose de plus divin que ce qui a trait à la pensée et à la réflexion?
ALCIBIADE : Nous ne le pouvons pas.
SOCRATE : C’est donc au divin que ressemble ce lieu de l’âme, et quand on porte le regard sur lui et que l’on connaît l’ensemble du divin, le dieu et la réflexion, on serait alors au plus près de se connaître soi-même.
ALCIBIADE : C’est ce qu’il semble.
Platon, Alcibiade majeur (IVème siècle av. JC), 132c-133e
Texte 2
Ce qui connaît tout et n’est connu par personne, c’est le SUJET. C’est par suite le support du monde (Träger der Welt), la condition générale, toujours présupposée, de tout ce qui se manifeste, de tout objet : car ce qui existe n’existe jamais que pour un sujet. Chacun se trouve être soi-même ce sujet, mais seulement en tant qu’il connaît, et non pas en tant qu’objet de connaissance. Objet, son corps l’est déjà, que nous nommons donc, de ce point de vue, représentation. Car le corps est un objet parmi les objets, soumis aux lois des objets, bien qu’il soit un objet immédiat. Comme tous les objets de l’intuition, il réside dans les formes de toute connaissance, dans le temps et l’espace, conditions d’existence de la multiplicité. Mais le sujet, ce qui connaît, mais n’est jamais connu, ne réside pas même dans ces formes (le temps et l’espace), qui, au contraire, le présupposent toujours déjà. Ni la multiplicité ni l’unité, son contraire, ne s’appliquent à lui. Nous ne le connaissons jamais, mais il est justement ce qui connaît, là où il n’en va que de la connaissance.
Arthur SCHOPENHAUER, Le Monde comme volonté et représentation, (1819) § 2, p. 80-81)
Texte 3
« La conscience, en général, n’a pu se développer que sous la pression du besoin de communication – dès le début, ce n’était que dans les rapports d’homme à homme, particulièrement entre celui qui commande et celui qui obéit, que la conscience était nécessaire, utile, et qu’en fonction du degré de cette utilité, elle arrivait à se développer. La conscience n’est en somme qu’un réseau de liens entre les hommes, – et ce n’est qu’en tant que telle qu’elle a dû se développer : à vivre isolé, telle une bête féroce, l’homme aurait pu fort bien s’en passer. Le fait que nos actes, nos pensées, nos sentiments, nos mouvements mêmes nous deviennent conscients – tout au moins une partie de ceux-ci – n’est que le résultat du règne effroyablement long qu’un « tu dois » a exercé sur l’homme ; il avait besoin, lui, l’animal le plus menacé, d’aide, de protection, il avait besoin de son semblable, il fallait qu’il sût se rendre intelligible pour exprimer sa détresse – et pour tout ceci il avait tout d’abord besoin de « conscience », donc même pour « savoir » ce qui lui faisait défaut, ’pour « savoir » ce qu’il éprouvait, pour « savoir » ce qu’il pensait. Car pour le dire encore une fois : l’homme, comme toute créature vivante, pense sans cesse, mais il l’ignore ; la pensée qui devient consciente n’est qu’une infime partie disons : la plus superficielle, la plus médiocre : – car seule cette pensée consciente se produit en paroles, c’est-à-dire dans des signes de communication par quoi se révèle d’elle-même l’origine de la conscience ». (…)
Ma pensée, comme on le voit, est que la conscience n’appartient pas au fond à l’existence individuelle de l’homme, bien plutôt à tout ce qui fait de lui une nature communautaire et grégaire ; que la conscience, par conséquent, ne s’est subtilement développée que sous le rapport de l’utilité communautaire et grégaire, et que, chacun de nous, nécessairement, en dépit de la meilleure volonté pour se comprendre aussi individuellement que possible, pour « se connaître soi-même », ne fera pourtant jamais autre chose que d’amener du non-individuel à sa conscience, ce qu’il a de plus « moyen » ; – que notre pensée même, constamment, se voit pour ainsi dire majorée par le caractère de la conscience – par le « génie de l’espèce », qui règne en elle – et retraduite dans la perspective du troupeau. Nos actes, dans le fond, sont intégralement et incomparablement personnels, uniques, individuels en un sens illimité, cela est hors de doute ; mais sitôt que nous les retraduisons dans la conscience, ils cessent de le paraître…
Friedrich NIETZSCHE, Le Gai Savoir (1882) §354
Texte 4
Dans le cours des siècles, la science a infligé à l’égoïsme naïf de l’humanité deux graves démentis. La première fois, ce fut lorsqu’elle a montré que la terre, loin d’être le centre de l’univers, ne forme qu’une parcelle insignifiante du système cosmique dont nous pouvons à peine nous représenter la grandeur. Cette première démonstration se rattache pour nous au nom de Copernic, bien que la science alexandrine ait déjà annoncé quelque chose de semblable. Le second démenti fut infligé à l’humanité par la recherche biologique, lorsqu’elle a réduit à rien les prétentions de l’homme à une place privilégiée dans l’ordre de la création, en établissant sa descendance du règne animal et en montrant l’indestructibilité de sa nature animale. Cette dernière révolution s’est accomplie de nos jours, à la suite des travaux de Ch. Darwin, de Wallace et de leurs prédécesseurs, travaux qui ont provoqué la résistance la plus acharnée des contemporains. Un troisième démenti sera infligé à la mégalomanie humaine par la recherche psychologique de nos jours qui se propose de montrer au moi qu’il n’est seulement pas maître dans sa propre maison, qu’il en est réduit à se contenter de renseignements rares et fragmentaires sur ce qui se passe, en dehors de sa conscience, dans sa vie psychique. Les psychanalystes ne sont ni les premiers ni les seuls qui aient lancé cet appel à la modestie et au recueillement, mais c’est à eux que semble échoir la mission d’étendre cette manière de voir avec le plus d’ardeur et de produire à son appui des matériaux empruntés à l’expérience et accessibles à tous. D’où la levée générale de boucliers contre notre science, l’oubli de toutes les règles de politesse académique, le déchaînement d’une opposition qui secoue toutes les entraves d’une logique impartiale.
Sigmund FREUD, Introduction à la psychanalyse (1916), IIème partie, chap. 18