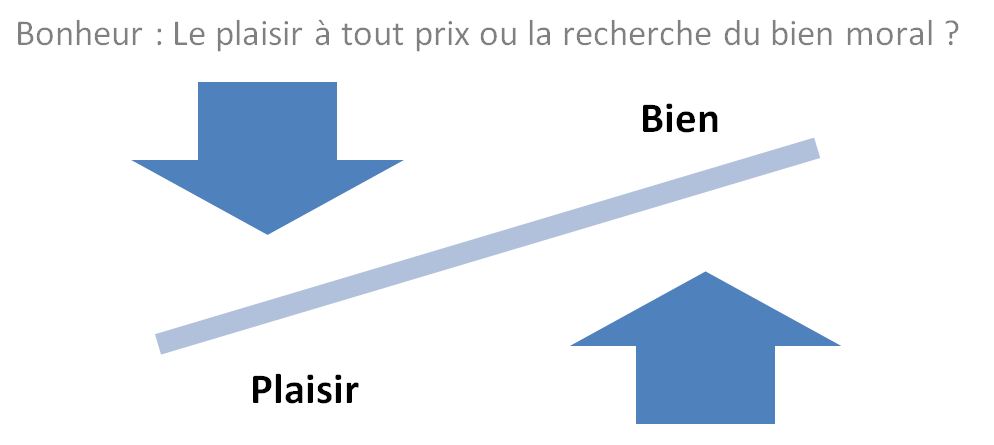Le texte de Kant ci-dessous, lu en cours, montre une voie par laquelle l’être humain devient un sujet. Ici, le sujet définit sa fonction d’une certaine manière en entretenant avec lui-même un rapport. Kant affirme que le sujet peut se concevoir comme unique et identique à lui-même. En effet, d’une part, nul ne peut être lui à sa place, et d’autre part, il ne devient pas quelqu’un d’autre. Pour bien comprendre l’extrait de l’Anthropologie du point de vue pragmatique, il faut prendre garde à la confusion qui prendrait l’acte de penser de la prise de conscience de soi avec les mots « je » ou « moi » pour se désigner soi-même.

« Posséder le Je dans sa représentation : ce pouvoir élève l’homme infiniment au-dessus de tous les autres êtres vivants sur la terre. Par-là, il est une personne ; et grâce à l’unité de la conscience dans tous les changements qui peuvent lui survenir, il est une seule et même personne, c’est-à-dire un être entièrement différent, par le rang et la dignité, de choses comme le sont les animaux sans raison, dont on peut disposer à sa guise ; et ceci, même lorsqu’il ne peut pas dire Je, car il l’a dans sa pensée; ainsi toutes les langues, lorsqu’elles parlent à la première personne, doivent penser ce Je, même si elles ne l’expriment pas par un mot particulier. Car cette faculté (de penser) est l’entendement.
Il faut remarquer que l’enfant qui sait déjà parler assez correctement ne commence qu’assez tard (peut-être un an après) à dire Je ; avant, il parle de soi à la troisième personne (Charles veut manger, marcher, etc.) ; et il semble que pour lui une lumière vienne de se lever quand il commence à dire Je ; à partir de ce jour, il ne revient jamais à l’autre manière de parler. Auparavant il ne faisait que se sentir ; maintenant il se pense. »
Kant, Anthropologie du point de vue pragmatique, §1.
Eléments pour une analyse du texte de Kant
Comment l’homme devient-il sujet ?
Cet extrait de l’Anthropologie du point de vue pragmatique de Kant est une analyse de l’importance qu’a le pouvoir de dire « je » pour le sujet humain que nous propose ici Kant. En effet pour Kant ce pouvoir élève l’homme au dessus de tous les autres êtres vivants, il est à l’origine de la supériorité et de la dignité de l’homme, c’est par la conscience que l’homme devient un être moral, autrement dit un être capable de se penser lui-même et donc de s’interroger sur la nature et la valeur de ses actes.
En quoi consiste le pouvoir de se penser soi-même ?
Dans un premier temps (1°§) Kant affirme cette supériorité de l’homme sur les autres êtres vivants « Posséder le Je dans sa représentation : ce pouvoir élève l’homme infiniment au-dessus de tous les autres êtres vivants sur la terre. ». Par ce pouvoir l’homme se constitue comme sujet pensant capable de se saisir soi-même par un retour sur soi de la pensée. « Posséder le Je dans sa représentation », cette expression désigne la capacité qu’a l’homme de se penser lui-même, de se constituer à la fois comme sujet et comme objet de ses propres pensées, littéralement de se rendre présent à lui-même.
La question à laquelle nous devons maintenant répondre est donc maintenant celle de savoir pourquoi, selon Kant « ce pouvoir élève l’homme infiniment au-dessus de tous les autres êtres vivants sur la terre » ? Kant nous dit que c’est par ce pouvoir que l’homme devient « une personne », ce terme ne peut en effet désigner que l’homme, dans la mesure où il définit un être morale qui tire sa moralité du fait qu’il reste le même quels que soient les changements qu’il puisse subir au cours de son existence. Être une personne, cela signifie former une unité au-delà de la diversité des états psychologiques du sujet, c’est être un sujet conscient et un, sujet qui reste le même dans le temps du fait même de cette conscience.
« Grâce à l’unité de la conscience dans tous les changements qui peuvent lui survenir, il est une seule et même personne » L’homme est donc un être qui, parce qu’il est en mesure de se penser lui-même, reste toujours lui-même, quoiqu’il fasse ou qu’il pense, c’est pourquoi l’on considérera d’ailleurs qu’il est toujours responsable des actes qu’il a commis, même si ceux-ci sont passés et se sont produits à une époque durant laquelle le sujet se trouvait dans des conditions matérielles et psychologiques différentes ; peut-être ne le jugera-t-on pas de la même façon, mais il sera toujours considéré comme étant en mesure de répondre de ses actes (ce qui est d’ailleurs le sens littéral de la notion de responsabilité).
Cette unité de la personne humaine résultant de la conscience de soi, explique que Kant puisse affirmer de l’homme qu’il est : « un être entièrement différent, par le rang et la dignité, de choses comme le sont les animaux sans raison, dont on peut disposer à sa guise ». En effet, l’homme n’est ni une chose, ni un animal, c’est un être vivant, mais qui, à la différence de l’animal, possède une dignité, c’est-à-dire qu’il ne se satisfait simplement de la seule satisfaction des besoins que lui impose la nature, il se doit de donner un sens et une valeur à son existence en poursuivant d’autres buts, en cherchant à réaliser des valeurs morales qui lui sont dictées par sa raison (générosité, courage, justice) et qu’il doit respecter lorsqu’il agit en étant le seul sujet de ses actions.
Certes, tous les hommes n’agissent pas conformément à ces valeurs, peut-être même sommes nous le plus souvent tentés d’agir en nous laissant dominer par nos intérêts égoïstes plutôt que par le respect des devoirs que nous dicte notre conscience ; mais n’est-ce pas précisément notre conscience qui nous donne la possibilité de faire le choix de résister à ces tentations, qui nous donne la liberté d’agir moralement ou non ? Et c’est précisément de cette liberté et des choix qu’elle rend possible que naît notre mérite qui fait notre dignité, ou au contraire si nous nous laissons dominer par des impulsions irrationnelles et déraisonnables, elle nous rend fautifs face à l’humanité qui est en nous et que nous n’avons pas respectée.
C’est la raison pour laquelle l’homme n’est pas une chose « comme le sont les animaux sans raison, dont on peut disposer à sa guise », c’est parce que la conscience lui donne ce pouvoir de dire je, cette capacité de se penser soi-même qui fait de lui un être libre et responsable et non un simple objet mû par les lois de la mécanique et la puissance aveugle de l’instinct, que l’homme est une personne, un sujet moral.
Cette capacité, tout homme la possède nous dit Kant, « et ceci, même lorsqu’il ne peut pas dire Je, car il l’a dans sa pensée; ainsi toutes les langues, lorsqu’elles parlent à la première personne, doivent penser ce Je, même si elles ne l’expriment pas par un mot particulier. Car cette faculté (de penser) est l’entendement. »
Certaines langues peuvent ne pas utiliser un terme particulier pour dire je (lorsque par exemple la conjugaison permet de désigner l’auteur de l’action sans qu’il soit nécessaire d’adjoindre au verbe un pronom personnel), cependant le simple fait de pouvoir parler à la première personne est la preuve même que ce que nous appelons le «je» est présent dans l’esprit de tout homme.
« Car cette faculté (de penser) est l’entendement. », ce pouvoir désigne en effet la capacité qu’a l’homme de penser et de se penser et le mot «je» n’est qu’un terme commode pour désigner cette capacité. Cette capacité, bien qu’inscrite dans la nature de l’homme, n’apparaît pas spontanément dès sa naissance, c’est d’ailleurs la raison pour laquelle l’enfant même lorsqu’il commence à parler n’est pas en mesure de s’exprimer à la première personne.
Genèse et naissance de la conscience de soi
Le pouvoir que possède le sujet humain de se penser lui-même n’existe initialement que sous forme de potentialité, il est présent en germe dans l’esprit de l’enfant et ne s’éveille que grâce aux stimulations du monde extérieur, c’est pourquoi : « l’enfant qui sait déjà parler assez correctement ne commence qu’assez tard (peut-être un an après) à dire Je »
En effet, comme le fait remarquer Kant, « avant, il parle de soi à la troisième personne (Charles veut manger, marcher, etc.) », autrement dit, même lorsqu’il sait parler, il ne se perçoit tout d’abord que comme un objet, cela signifie d’ailleurs que le fait de dire «je» ne provient pas seulement d’un progrès dans la maîtrise du langage, mais également d’un progrès sur le plan existentiel et psychologique.
Cette acquisition plutôt tardive (cet événement apparaît généralement vers l’âge de trois ans), se manifeste comme une sorte d’éveil du sujet à lui-même, éveil qui le fait entrer dans un univers nouveau duquel il ne pourra plus sortir, dans le mesure où il fait un saut qualitatif irréversible en ce qui concerne la perception qu’il a de lui-même et de sa place dans le monde.
« Et il semble que pour lui une lumière vienne de se lever quand il commence à dire Je; à partir de ce jour, il ne revient jamais à l’autre manière de parler. » Ce passage à la conscience de soi est donc décisif dans la mesure où l’enfant devient réellement humain, il accède ainsi à une perception de soi qui n’est plus immédiate et simplement sensible, mais qui se situe au niveau supérieur de la représentation par la pensée. Ainsi le sujet peut prendre une distance suffisante par rapport à lui-même afin de juger de la portée de ses actes et de ses pensées, ce qui fait de lui un sujet moral, ce qui définit son humanité.
La conscience de soi comme la condition de la liberté et donc de la dignité morale de la personne humaine
Pour conclure, disons que l’intérêt de ce texte est donc de montrer en quoi la conscience de soi est pour l’homme la condition de sa liberté et donc de sa dignité morale, « Posséder le Je dans sa représentation » c’est pouvoir se penser soi-même, prendre un recul par rapport à soi qui donne à l’homme la capacité de choisir, et ce pouvoir de choix fait que nous sommes nécessairement responsables de nos actes, que nous sommes en mesure d’échapper au déterminisme naturel pour poursuivre des fins dont seul l’homme peut reconnaître la valeur.